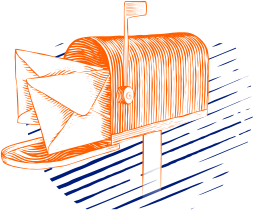January 08, 2018
Alexander Main
Le Monde diplomatique, janvier 2018
Le Monde diplomatique en español, janvier 2018
Jacobin, 8 janvier 2018
NACLA, 11 janvier 2018
Voir l’article à la source d’origine.
Des soldats le doigt sur la gâchette en plein milieu de la route, des manifestants qui courent chercher un abri au milieu des nuages de gaz lacrymogène… Début décembre 2017, les rues de Tegucigalpa, la capitale hondurienne, présentaient tous les signes d’un coup d’État militaire, rappelant le climat de juin 2009, lorsque le président de gauche Manuel Zelaya fut enlevé par l’armée et embarqué de force dans un avion à destination du Costa Rica.
Cette fois, ce sont de sérieux indices de fraude électorale qui ont mis le feu aux poudres. L’élection présidentielle du 26 novembre dernier s’est tenue dans un climat d’extrême tension, marquée par la crainte que le Tribunal suprême électoral (TSE), acquis au Parti national du Honduras (PNH) au pouvoir, soit prêt à tout pour garantir un second mandat au président sortant, M. Juan Orlando Hernández, contesté pour ses dérives autoritaires et son implication dans des affaires de corruption. À cette crainte s’ajoute une certitude : Washington ne serait pas indifférent au résultat de son poulain, garant du maintien d’une politique ultralibérale et de la militarisation du pays.
Difficile de déterminer à quel moment précis dans l’histoire du Honduras est apparue l’expression « proconsul » pour désigner l’ambassadeur des États-Unis. Le terme jouissait déjà d’une large popularité au début des années 1980, quand l’ambassade américaine à Tegucigalpa accompagna — pour ne pas dire orchestra — la fragile transition de la dictature militaire hondurienne vers un régime de démocratie conditionnelle et militarisée. La mission confiée au proconsul en poste à cette époque, M. John Negroponte, était parfaitement claire : s’assurer que le Honduras serve de plate-forme de coordination pour la guerre clandestine menée par l’administration Reagan contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua et contre les mouvements de gauche au Salvador ou au Guatemala. Ce qui impliquait non seulement une forte présence militaire américaine au Honduras, mais aussi la mise sous contrôle de la vie politique intérieure du pays.
Une vie au rythme des casernes
Les troupes américaines, sous M. Negroponte, renforcèrent leur occupation de la base aérienne de Soto Cano, souvent perçue par les Honduriens comme une enclave yankee. L’aide militaire des États-Unis au Honduras passa de 4 millions de dollars en 1981 à 77,4 millions en 1984. Tout en reconnaissant en interne que les forces armées honduriennes commettaient des « centaines de violations des droits humains (…), dont la plupart pour des motifs politiques », la Central Intelligence Agency (CIA) a accordé son appui aux escadrons de la mort qui, à l’instar du Bataillon 3-16, de sinistre réputation, ont torturé, tué, ou fait disparaître par dizaines des syndicalistes, des universitaires, des paysans et des étudiants. L’ambassade américaine entretenait des liens étroits avec les commandants de ces phalanges. Comme le révèlent des documents déclassifiés, M. Negroponte s’est impliqué personnellement pour faire obstacle à toute divulgation de ces atrocités d’État, afin d’éviter, disait-il, de « créer des problèmes de droits humains au Honduras » (1).
Ce n’est qu’en 2006 que le système échafaudé par M. Negroponte — qui sera promu ambassadeur aux Nations unies puis secrétaire d’État adjoint par le président George W. Bush — commence à s’effriter. Élu président cette année-là, M. Manuel Zelaya, un riche propriétaire terrien qui s’était porté candidat avec l’étiquette libérale, s’engage sans prévenir et à la stupéfaction générale dans une politique de gauche. En rompant spectaculairement avec ses prédécesseurs, M. Zelaya se rapproche du président vénézuélien Hugo Chávez, l’épouvantail de Washington, et prononce l’adhésion du Honduras à l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA), que ce dernier a mis en place pour faire pièce à l’influence des États-Unis. Audace suprême, M. Zelaya prend langue avec les mouvements sociaux opposés à la présence militaire américaine et appelle à la création d’une assemblée constituante chargée de remplacer la loi fondamentale de 1982, adoptée sous la tutelle de Washington, par une nouvelle Constitution d’inspiration progressiste.
Lorsque le président annonce son intention de consulter les Honduriens sur la question de savoir si la convocation d’une assemblée constituante doit faire l’objet d’un référendum, les généraux et les notables décident de se faire justice sur-le-champ. Au prétexte, avancé sans la moindre preuve, que M. Zelaya chercherait à modifier la Constitution en vue de s’accrocher indéfiniment au pouvoir, les principaux dirigeants des deux partis dominants accueillent avec une joie sans réserve le coup d’État militaire du 28 juin 2009.
Si l’administration Obama a fini, après quelques tergiversations, par condamner le putsch au Honduras, elle n’en a pas moins pesé de tout son poids pour empêcher M. Zelaya de rentrer dans son pays. Sous la houlette de Mme Hillary Clinton, le département d’État a par ailleurs affiché son soutien aux élections organisées par le gouvernement issu du coup d’État, en s’abstenant de réclamer au préalable la restauration de M. Zelaya dans ses fonctions.
Pour de nombreux Honduriens, l’ordre instauré depuis le coup d’État de 2009 rappelle à plus d’un titre les sinistres années 1980. Le pays vit à nouveau au rythme des casernes. Les troupes déployées sur l’ensemble du territoire après l’expulsion de M. Zelaya ont reçu carte blanche pour réprimer les protestations quasi quotidiennes des opposants au coup d’État. Contrôlés par le PNH, les gouvernements issus des élections décriées de 2009 et de 2013 institutionnalisent le travail de police confié aux militaires en violation de la Constitution hondurienne. Comme président du Congrès, M. Hernández avait œuvré à la validation législative de la nouvelle garde prétorienne du régime, la police militaire de l’ordre public (PMOP). Sur le point d’être élu président en 2014, il crée les Tigres, des unités de police militarisées formées par les États-Unis et commandées par des officiers notoirement impliqués dans des scandales de corruption.
La remilitarisation du Honduras coïncide avec la restauration d’un climat de confort optimal pour les familles fortunées et les investisseurs internationaux, à l’attention desquels le gouvernement a lancé la campagne « Honduras is open for business » (« Faites des affaires au Honduras »). Pour prévenir les risques de conflits sociaux, le pouvoir a pris soin de concentrer les forces de sécurité dans les zones dévolues à l’industrie minière, aux barrages électriques, au secteur agroalimentaire et au tourisme, c’est-à-dire aux intérêts potentiellement les plus nocifs pour les populations environnantes. Nombre de projets industriels ont été mis en œuvre illégalement, sans la consultation préalable, requise par la loi, des communautés indigènes qui en subissent les conséquences. Selon les organisations de défense des droits humains, il n’est pas rare que les militaires s’allient à des sociétés de sécurité privée pour briser les résistances locales par la terreur, parfois même par des campagnes d’assassinats ciblés, comme celui de la dirigeante indigène écologiste Berta Cáceres.
Le système politique que les États-Unis ont contribué à bâtir au Honduras, mélange d’autoritarisme kaki et de détournements de fonds, montre toutefois des signes d’usure. Le mouvement de résistance au putsch de 2009 a donné naissance à une nouvelle formation politique, le Parti Liberté et refondation (Libre), qui remet en question le statu quo du bipartisme. À l’élection de 2013, en dépit des fraudes massives qui ont altéré le scrutin et d’une campagne d’intimidation sanglante marquée par l’assassinat d’au moins dix-huit candidats et militants du parti, Libre est arrivé en deuxième position au Congrès, avec trente-sept sièges.
Le régime est fragilisé en outre par les affaires de prévarication qui se succèdent au plus haut niveau et par l’implication de plusieurs dignitaires dans des circuits de trafic de drogue, parmi lesquels le frère du président Hernández et l’ancien président Porfirio Lobo. En 2015, une vague de révolte a déferlé sur le pays après la découverte que des fonds collectés via un réseau de corruption avaient servi à financer la campagne électorale de M. Hernández en 2013. Grâce à la médiation empressée de Washington et de l’Organisation des États américains (OEA), une solution politique a pu être trouvée, qui, tout en excluant les principaux groupes d’opposition, a permis au président hondurien d’échapper au sort de son homologue du Guatemala, M. Otto Pérez Molina, incarcéré en 2015 dans l’attente de son procès pour détournements de fonds.
Comme pour ruiner un peu plus la légitimité du gouvernement, la Cour suprême de justice du Honduras — contrôlée elle aussi par le PNH — a jugé en 2016 que l’article de la Constitution interdisant au président de briguer un second mandat pouvait être ignoré au nom… des droits humains. L’ironie de cette décision, tombée sept ans après que M. Zelaya fut déchu de son poste pour avoir prétendument envisagé de se représenter, n’a pas échappé aux Honduriens, qui ont largement protesté dans la rue contre ce nouveau coup de force.
En prévision de l’élection de novembre 2017, Libre a formé une coalition avec deux autres petits partis, l’Alliance de l’opposition contre la dictature. Dans l’espoir de rallier à sa cause l’électorat modéré, celle-ci s’est entendue sur la candidature du centriste Salvador Nasralla, un homme d’affaires engagé dans la lutte contre la corruption, par ailleurs journaliste et animateur de télévision très connu dans le pays. À ses côtés, Mme Xiomara Castro de Zelaya, épouse du président destitué, briguait le poste de vice-présidente.
Le jour de l’élection, le TSE annonce être en mesure de fournir des résultats provisoires en début de soirée. À minuit, cependant, alors que MM. Hernández et Nasralla revendiquent chacun la victoire, le TSE tarde toujours à donner de ses nouvelles. Selon le témoignage confié plus tard à la presse par un membre dissident de cet organisme, M. Marco Ramiro Lobo, l’équipe technique du TSE aurait fait savoir en interne, peu après la fermeture des bureaux de vote, que le décompte de 57 % des voix faisait apparaître une tendance nette et irréversible en faveur de M. Nasralla. Pendant plusieurs heures, le président du TSE, M. David Matamoros — un ancien congressiste du PNH —, refuse pourtant de faire état de ces résultats partiels, jusqu’à ce que, sous la pression des observateurs internationaux et de M. Lobo lui-même, il finisse par tenir sa promesse, en se gardant toutefois de prononcer le mot « irréversible » à propos de la tendance qui se dégage.
C’est alors que le décompte des voix — diffusé jusque-là en direct sur le site Internet du TSE — s’interrompt brusquement. La mystérieuse panne dure environ trente heures. D’après M. Lobo, c’est M. Matamoros qui, sans un mot d’explication, aurait donné l’ordre de stopper le processus de comptage. Quand celui-ci reprend, à la cadence d’un escargot, l’avance de cinq points accordée initialement à M. Nasralla commence à s’éroder. Le 30 novembre, le président Hernández est en définitive proclamé vainqueur, avec un point et demi d’écart par rapport à son rival.
Cent cinquante plaintes pour fraude
Sous la pression de la rue et des observateurs internationaux, M. Matamoros finit par effectuer un recomptage partiel des voix. Quelques jours plus tard, la chargée d’affaires des États-Unis Heide Fulton à ses côtés, il affirme : « Ce que nous trouvons dans les urnes confirme ce que nous avons compté le jour de l’élection. » Avant d’annoncer, le 17 décembre, que « le président réélu pour la période de 2018 à 2022 est le citoyen Juan Orlando Hernández Alvarado ». Les élections ont été « d’une transparence jamais vue au Honduras », conclut-il.
Des dizaines de milliers de Honduriens mécontents descendent alors dans la rue. En guise de réponse, le gouvernement déclare le couvre-feu et déploie l’armée et la police aux quatre coins du pays. La vague de répression est meurtrière. L’Organisation des Nations unies (ONU) et la Commission interaméricaine des droits de l’homme, « préoccupées », comptent douze manifestants tués, des dizaines de blessés et des centaines d’autres arrêtés au cours de la première quinzaine de décembre. Dans l’après-midi du 9 décembre, alors que les forces de sécurité continuent de faire régner la terreur sous ses fenêtres, le TSE se réunit dans une ambiance détendue à son siège, en centre-ville. Son président s’apprête à faire une déclaration quand la chargée d’affaires américaine prend le microphone pour saluer le travail de l’autorité électorale et appeler le peuple hondurien à respecter le résultat officiel de l’élection. Qu’importent les quelque cent cinquante plaintes pour fraude déposées par les partis d’opposition : le soutien de Washington semblait garantir que le président Hernández se maintiendrait au pouvoir, libre de poursuivre, au moins jusqu’en 2021, sa politique ultralibérale et la militarisation du pays.
À la surprise générale, la mission d’observation de l’OEA — qui avait brillé par son atonie face à la fraude électorale de 2013 — refuse cette fois d’avaler la couleuvre. Elle présente un rapport accablant des irrégularités dans le processus électoral et conclut que des doutes persistent quant aux résultats du vote. Tous les regards se tournent vers Washington. Si l’OEA, instrument-clé de l’hégémonie américaine dans la région, se dit prête à mettre en cause la victoire de M. Hernández, alors tout semble possible, y compris un revirement de la politique envers le Honduras. Vingt-quatre heures passent sans la moindre réaction de la part du gouvernement américain. Finalement, le soir du 18 décembre, le département d’État annonce prendre acte de la victoire de M. Hernández. Aucune mention du rapport de l’OEA.
Dans les heures qui suivent, les gouvernements de droite proches de Washington félicitent, un par un, M. Hernández : Guatemala, Colombie, Mexiqu… Pendant ce temps, une nouvelle vague de manifestations paralyse les principales voies des grandes villes du Honduras.
Alexander Main. Analyste politique au Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC.