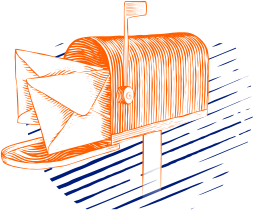November 27, 2017
Deborah James
Réseau québécois sur l’intégration continentale, 25 novembre 2017
Salon, 24 novembre, 2017
AlterNet, 20 novembre 2017
Common Dreams, 17 novembre 2017
Agencia Latinoamericana de Informacion, 17 novembre 2017
Voir l’article à la source d’origine
Au début des années 1990, les multinationales ont obtenu des accords à l’OMC dans l’agriculture, les services, les produits pharmaceutiques et l’industrie pour verrouiller des droits qui leur permettent de participer aux marchés dans des conditions favorables, tout en limitant la capacité des gouvernements à réglementer et façonner leurs économies. Les sujets correspondaient à l’agenda des multinationales de l’époque.
Aujourd’hui, les plus grandes multinationales essaient aussi de verrouiller des droits et menotter les réglementations dans l’intérêt public par des accords commerciaux, y compris à l’OMC. Mais maintenant les cinq plus grandes multinationales relèvent toutes d’un seul secteur : la technologie ; et d’un seul pays : les Etats-Unis. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, avec le soutien d’autres entreprises et des gouvernements du Japon, Canada et de l’UE (avec quelques pays en développement alignés sur leurs positions), essaient de réécrire les règles de l’économie numérique du futur en obtenant à l’OMC le mandat de négocier des règles contraignantes sous l’apparence du “commerce électronique.”[i]
Mais les règles qu’ils recherchent vont beaucoup plus loin que ce que la plupart d’entre nous entendons par « commerce électronique ». Leur agenda consiste surtout à assurer le libre – pour eux – accès à la ressource la plus précieuse du monde – le nouveau pétrole, les données. Ils veulent pouvoir être libres de capturer les milliards de données que nous, en tant qu’être humains connectés, produisons chaque jour, les transférer où ils veulent et les stocker dans des serveurs où ils veulent, pour la plupart aux Etats-Unis. Ceci constituerait un danger pour la sphère privée et la protection des données dans le monde entier, vu la carence de protection juridique des données aux Etats-Unis.
Ensuite ils peuvent traiter les données pour le renseignement, les conditionner et les vendre à des parties tierces pour en tirer des profits énormes s’apparentant à des rentes monopolistiques. C’est aussi la matière première de l’intelligence artificielle, basée sur l’accumulation massive de données pour « former» des algorithmes qui permettent de prendre des décisions. Dans l’économie du futur, celui qui possède les données va dominer le marché. Ces entreprises sont déjà très critiquées pour leurs comportements monopolistiques et oligopolistiques, qui seraient consolidés par ces propositions.
Pensez à Google, qui est devenu le plus important collecteur de recettes publicitaire grâce à sa capacité à analyser et reconditionner nos données. Et pensez à Uber : c’est la plus grande entreprise de transport au monde, alors qu’elle ne possède pas de voitures et n’emploie aucun chauffeur. Son atout principal, c’est l’énorme quantité de données qu’il détient sur la façon dont les gens se déplacent en ville. Et avec cet avantage de « premier instigateur », son bataillon d’avocats et sa taille impressionnante, il peut éjecter du marché ou simplement racheter des concurrents dans le monde entier. Les perturbations qu’Uber a causées dans le secteur des transports se feront bientôt sentir dans tous les secteurs. Les conséquences pour les emplois et les travailleurs sont difficiles à sur-estimer.
Une autre règle d’or que ces multinationales cherchent à obtenir permettrait aux entreprises de services digitaux d’opérer et faire du profit dans un pays sans devoir y avoir une présence physique ou légale. Mais si une entreprise de services financiers en ligne fait faillite, comment les épargnants peuvent-ils se faire dédommager ? Si les droits d’un travailleur (ou d’un contractuel) d’une entreprise sont violés, ou un consommateur est escroqué, comment peuvent-ils obtenir justice ? Et si l’entreprise n’a pas de présence locale, comment peut-elle être taxée convenablement pour être au même niveau qu’une entreprise nationale ? La plupart des pays exigent que les fournisseurs de services étrangers aient une présence commerciale et physique dans le pays, précisément pour ces raisons ; mais les Big Tech le voient juste comme une barrière au commerce (et au profit illimité). Les réglementations dans l’intérêt public seraient sérieusement menacées.
Mais ce n’est pas tout. Les Big Tech ne veulent pas non plus devoir bénéficier aux économies locales où elles font du profit. La plupart des pays utilisent toute une série de politiques pour s’assurer que la présence des multinationales profite à l’économie locale: exiger le transfert de technologies pour alimenter les startups ; exiger des intrants locaux pour soutenir les entreprises locales ; et exiger d’engager du personnel local pour promouvoir l’emploi. Mais bien que les pays développés aient utilisé ces stratégies pour se développer, aujourd’hui ils essaient « d’enlever l’échelle » pour que les pays en développement ne puissent pas faire pareil, ce qui augmente les inégalités entre les pays.
Le modèle d’affaires de beaucoup de ces entreprises se base sur trois stratégies qui ont des impacts sociaux très négatifs: déréglementation; augmentation de la précarisation du travail; et optimisation fiscale, qui pour beaucoup d’apparente à l’évasion fiscale. Toutes ces tendances vers le bas seraient accélérées et verrouillées si ces règles proposées sur le « commerce électronique » étaient acceptées à l’OMC.
Depuis que certains pays ont proposé des règles sur le “commerce électronique” à l’OMC l’année passée, ils ont essayé de transformer un mandate existant pour “discuter” du commerce électronique en un mandat pour “négocier des règles contraignantes” sur le commerce électronique. Ils se sont justifiés en affirmant que le commerce électronique va promouvoir le développement et bénéficier aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) – comme si promouvoir le commerce électronique était la même chose qu’avoir des règles contraignantes écrites par les multinationales. Mais les pays en développement ont concentré leurs requêtes sur l’amélioration de l’infrastructure, l’accès à la finance, le dépassement du clivage numérique (obtenir un accès abordable), l’augmentation de la capacité de régulation et d’autres questions qui ne seront pas résolues par de nouvelles règles sur le commerce électronique à l’OMC. Un groupe de 90 pays a présenté pendant longtemps des propositions à l’OMC qui leur donneraient plus de flexibilité pour mettre en œuvre des politiques nationales susceptibles de promouvoir le développement – mais dans les négociations elles sont régulièrement ignorées.
Pendant ce temps, les MPME peuvent déjà participer au commerce électronique; mais elles seront moins susceptibles de profiter des économies d’échelle, des subventions historiques, de l’infrastructure solide sponsorisée par l’Etat, des stratégies d’évitement fiscal et d’un système de règles commerciales écrit pour les multinationales et par leurs avocats si les règles sur le commerce électronique sont adoptées à l’OMC. Les MPME ont besoin de politiques porteuses d’une stratégie d’industrialisation digitale ; mais les politiques envisagées par les pays qui les proposent sont plus susceptibles de mener à un nouveau « colonialisme digital ».
A ce stade, les partisans ont réduit leurs ambitions à cause d’une résistance massive de la part du bloc africain et de certains membres asiatiques et latino-américains. Maintenant ils proposent des questions apparemment plus techniques, comme les paiements électroniques, les signatures électroniques et les spams. Mais ces questions relèvent d’autres fora, comme la Conférence des Nations Unies sur le droit commercial international (UNCITRAL) ou l’Union internationale des télécommunications (UIT), où des experts juridiques et techniques, plutôt que des intérêts commerciaux, aident depuis longtemps les gouvernements à établir de meilleures règles.
Peut-être comme plan B, les partisans affirment que la “neutralité technologique” existe déjà à l’OMC. Ceci voudrait dire que si un pays « a engagé » des services financiers à l’OMC – c’est à dire qu’il a accepté que ses services financiers soient soumis à des règles qui limitent les réglementations dans ce secteur – , alors les services bancaires transfrontaliers en ligne seraient déjà engagés, avec toutes les menaces potentielles de cyber sécurité comme le hacking, ou des flux financiers instables qui font des ravages sur les systèmes bancaires locaux. Mais c’est une idée ridicule et les membres de l’OMC ne se sont pas mis d’accord là-dessus, malgré l’intention de certains pays de l’établir comme un principe accepté.
Les partisans poussent aussi pour renouveler une exemption sur les droits de douane sur les produits délivrés électroniquement. Mais il n’y a pas de justification rationnelle pour que les produits échangés électroniquement ne contribuent pas à la base fiscale nationale, alors que ceux qui sont échangés de façon traditionnelle le font. Les Big Tech peuvent effectivement obtenir cette exemption puisqu’elle est souvent « échangée » contre une exemption qui aide à stabiliser le marché des médicaments génériques dans les pays en développement, pour garantir l’accès aux médicaments sauveurs de vie à des millions de personnes.
Le résultat à Buenos Aires[ii] va dépendre de la forte résistance des pays en développement à ce nouvel agenda des Big Tech. Ils devraient être aidés par une forte résistance de la société civile à d’autres impositions de règles favorables aux multinationales qui empiètent sur notre vie quotidienne.
[i] “Twelve Reasons to Oppose Rules on Digital Commerce in the WTO,” by Deborah James, Huffington Post, May 12, 2017, http://www.huffingtonpost.com/entry/5915db61e4b0bd90f8e6a48a.
[ii] “Lettre de la société civile internationale sur l’agenda en vue de la 11ème conférence ministérielle de l’OMC,” 6 octobre 2017, signée par 300 organisations de la société civile, disponible en français à: http://notforsale.mayfirst.org/en/signon/11th-wto-ministerial-letter-global-civil-society-about-agenda-wto
Deborah James est la directrice des programmes internationaux du Center for Economic and Policy Research (www.cepr.net) et elle coordonne le réseau international Notre monde n’est pas à vendre (OWINFS)